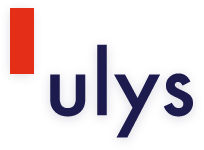Vendée Globe : la mention « n’a pas fini » attribuée à un skipper arrivé hors délai, est-elle exacte au sens du RGPD ?
Publié le 02/04/2025 par
Etienne Wery
73 vues
Le skipper Denis Van Weynbergh a terminé le Vendée Globe, mais hors délai. Il a été classé « DNF » (« Did Not Finish »). Cette mention est-elle conforme au RGPD ? Le règlement de course est ce qu’il est et impose un temps limite, mais le RGPD exige que les données soient exactes au regard de leur finalité.…
Le skipper Denis Van Weynbergh a terminé le Vendée Globe, mais hors délai. Il a été classé « DNF » (« Did Not Finish »). Cette mention est-elle conforme au RGPD ? Le règlement de course est ce qu’il est et impose un temps limite, mais le RGPD exige que les données soient exactes au regard de leur finalité. Or, dire qu’il n’a pas fini alors qu’il a franchi la ligne d’arrivée peut induire en erreur, notamment pour la finalité que constitue la communication du classement au public. Si la mention « DNF » est inexacte, elle doit être mise à jour.
Arrivé hors délai … mais arrivé tout de même
Dans les régates, le classement officiel obéit à des règles strictes. Le skipper belge Denis Van Weynbergh en a fait l’expérience : il a franchi la ligne d’arrivée du dernier Vendée Globe après le temps limite fixé par la direction de la course. Quelques heures de retard à peine, peu de chose en somme pour un périple pareil, mais le règlement est strict et la direction de course intransigeante.
Dans le classement publié en ligne :
- Les 32 skippers arrivés dans les temps apparaissent, classés par ordre d’arrivée ;
- Les 7 skippers qui ont abandonné sont repris en fin de classement avec une mention « abandon » ;
- Le malheureux Van Weynbergh se voit affublé d’une mention « DNF » pour « Did Not Finish ».
Depuis lors, le skipper ne rate pas une occasion de dire le mal qu’il pense de l’intransigeance de la direction de course.
Sa déception est compréhensible, mais que peut-il faire ?
Le premier réflexe consiste à contester le règlement, voire remettre en cause le principe même du non-classement pour quelques heures de retard. La tâche ne sera pas aisée car l’inscription implique l’adhésion au règlement, et le règlement est clair. Par ailleurs, sauf à imaginer que la ligne d’arrivée reste ouverte de façon permanente, il est légitime pour l’organisateur d’un évènement sportif, quel qu’il soit, de clôturer l’évènement à un moment donné.
Autre réflexe : invoquer l’exception sportive. L’esprit du sport s’accommode-t-il d’une attitude aussi rigoriste ? Le navigateur a réalisé son tour du monde, en solitaire, sans escale ni assistance. Il a réalisé un exploit humain, technique et sportif. Ne peut-on, pour quelques heures à peine et ce qu’elles représentent par rapport aux mois passés en mer, faire preuve de souplesse ? L’idée est sympathique, mais irréaliste : à ce niveau, le sport est une activité économique d’où tout romantisme est exclu. La direction de course n’a aucun intérêt à verser dans l’émotion ; elle nuirait aux éditions futures qui voient s’affronter des sportifs, mais aussi des marques, des budgets, des technologies, des annonceurs, etc.
Le RGPD au secours du skipper ?
Et si la solution venait plus simplement du RGPD … ?
L’article 5 d) énonce, au rang des principes, que les données personnelles doivent être « exactes et, si nécessaire, tenues à jour ». Il poursuit en précisant que « toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude) ».
L’article 5 crée une obligation à charge du responsable de traitement.
L’article 16, quant à lui, crée un droit de correction au profit de la personne visée : elle « a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire ».
Il n’y a pas de préjudice ou de dommage à établir : le droit de correction est ouvert du simple fait que la donnée est inexacte.
Qu’est-ce qu’une donnée « exacte » ?
Il ressort du libellé des dispositions précitées que la détermination de l’exactitude dépend des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Aussi bien l’article 5 d) que l’article 16 y font allusion.
La CJUE le confirme : il est nécessaire de se placer dans le contexte de la collecte de la donnée personnelle, c’est-à-dire « au regard de la finalité pour laquelle elle est collectée », pour apprécier son exactitude (voir, par analogie, CJUE, 20 décembre 2017, Nowak, C‑434/16, point 53).
Véracité et exactitude ne sont donc pas, dans ce contexte, synonymes : la véracité renvoie à la fiabilité (vrai/faux) de l’information, tandis que l’exactitude au sens du RGPD renvoie au lien entre la donnée et la finalité du traitement.
Pour autant, véracité et exactitude entretiennent un lien qui ressort de l’arrêt Costeja (droit à l’oubli), que feu le groupe G29 avait confirmé, estimant dans les Lignes directrices relatives à cet arrêt que « En règle générale, « exact » s’entend au sens de « exact par rapport à un fait ».
La situation est donc subtile : l’exactitude de l’information doit être analysée dans le contexte de la finalité du traitement, mais aussi en prenant en compte son caractère plus ou moins objectif. La Cour a du reste admis que la personne concernée peut parfois être tenue de fournir des éléments de preuve pertinents et suffisants, qui peuvent raisonnablement être exigés d’elle, pour évaluer l’exactitude (voir, par analogie CJUE, 8 décembre 2022, TU, RE c. Google, C‑460/20, points 68 et 72 et CJUE, 13 mars 2025, VP, C 247/23)
S’il a fait 15 degrés à Bruxelles le 1er avril 2025 à la station météo officielle, cette information, objective par nature, est toujours exacte, quel que soit le contexte ou la finalité. Écrire qu’il a fait beau ce jour-là est une information qui s’éloigne de l’objectivité et dont l’exactitude dépend du contexte. Il en va de même sur le plan de l’exactitude au sens du RGPD : plus une information est objective plus il sera difficile d’en critiquer l’exactitude au sens des articles 5 et 16, mais dès l’instant où l’information véhicule une part de subjectivité il faut la replacer dans le contexte, et en premier lieu la finalité, pour se prononcer sur cette question.
S’il y a plusieurs finalités, la Cour a pour habitude de vérifier la conformité au RGPD pour chacune, ce qui signifie qu’une donnée pourrait être déclarée inexacte pour certaines finalités mais pas toutes.
Nous n’avons pas eu l’occasion de lire les documents de course qui définissent peut être plus précisément les finalités, mais si l’on veut bien admettre que les noms des skippers sont des données personnelles, traitées notamment pour les finalités (probables) que sont d’une part l’établissement du classement et d’autre part sa communication au public, il faut alors admettre que le skipper a de bonnes chances d’obtenir la rectification de la mention « DNF » qui, au regard de ces finalités-là (au moins), apparait inexacte.
D’une part, sur le plan de l’objectivité, il n’est pas évident que « finir hors délai » puisse être considéré comme un synonyme de « ne pas finir ». Il en résulte qu’établir un classement dans lequel un candidat est qualifié de « non-finisher » au motif qu’il a franchi la ligne d’arrivée après le temps règlementaire, est discutable indépendamment de la finalité poursuivie. En l’espèce, la situation est en effet étonnante : une fois le temps officiel dépassé, la course n’est pas arrêtée : on attend le dernier avant d’éteindre les lampions. On ne confondra donc pas cela avec l’hypothèse d’une personne inscrite au marathon de Paris, qui fait la course à son rythme en 6 jours au lieu de 6 heures, : elle ne pourra pas prétendre à la correction de la mention « DNF » au motif qu’elle a suivi le parcours jusqu’à la ligne d’arrivée. Le cas d’espèce est différent : la mesure du temps s’arrête en vue du classement, mais l’évènement qu’est la course se poursuit, et c’est cette nuance qui rend la donnée DNF discutable sur le plan objectif.
D’autre part, le classement d’une compétition comme le Vendée Globe a vocation à être communiqué au public, ce qui constitue, probablement, une finalité en soi. Or, le public comprend un ensemble large de personnes parmi lesquelles un certain nombre n’est pas au courant des subtilités des courses en mer et comprendra la mention « Did Not Finish » pour ce qu’elle est à première vue : le parcours n’a pas été effectué jusqu’au bout, ce qui ne reflète pas la subtilité de la réalité et signifie qu’au regard de la finalité d’information qu’est la communication du classement au public, la donnée n’est, a priori, pas « exacte ».
On arrive à la même conclusion en appliquant le principe de proportionnalité. Le RGPD renvoie indirectement à ce principe général quand il exige que « toutes les mesures raisonnables » soient prises (art. 5). Le remplacement de la mention DNF par une autre, qui reflète mieux la réalité, n’implique pas de changement ou de coût significatif du côté de l’organisateur tout en assurant pleinement la finalité pour laquelle l’information est traitée. Du reste, certains éléments ont été modifiés par l’organisation depuis lors, mais pas la mention DNF.
Décidément, le RGPD est partout … même en mer !