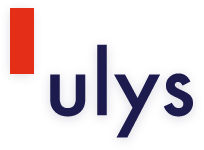Une violation contractuelle engage-t-elle toujours la responsabilité delictuelle du co-contractant lorsque le contrat porte sur une oeuvre ?
Publié le 24/04/2013 par
Etienne Wery
Lorsque deux parties sont en relation contractuelle au sujet d’un objet protégé par la propriété intellectuelle, toute violation du contrat est-elle forcément une contrefaçon ? L’enjeu est important, tantau niveau du cadre juridique applicable, que de la compétence du juge saisi. C’est indirectement à une question similaire que la cour de justice répond.
A l’occasion d’un litige opposant la commission européenne à l’éditeur de logiciels, la cour de justice a peut-être jeté un fameux pavé dans la mare.
Au départ, le litige paraît banal, si ce n’est qu’il implique la commission européenne.
Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que par le détour de la compétence du juge saisi, la cour de justice ouvre une porte dans un débat qui secoue régulièrement les prétoires et qui consiste à savoir si la violation d’un contrat qui porte sur un objet protégé par de la propriété intellectuelle, est forcément une contrefaçon. Deux écoles s’affrontent :
- celle qui prétend que le débat peut se limiter au cadre contractuel (le contrat est-il respecté et sinon, que puis-je attendre de mon contractant ?) ;
- Celle qui prétend que dès l’instant où l’objet du contrat est un élément protégé par la propriété intellectuelle, toute violation du contrat est une violation des prérogatives exclusives de l’auteur et constitue, partant, une contrefaçon.
L’enjeu n’est pas mince.
Parfois, selon que la matière est contractuelle ou délictuelle, le juge est compétent ou ne l’est pas. A titre d’exemple, selon le cas, le juge des cessations commerciales est compétent si le fait litigieux constitue en même temps une violation contractuelle et une atteinte à une prérogative de l’auteur. Si chaque violation contractuelle est forcément une atteinte aux prérogatives de l’auteur, le juge des cessations commerciales sera toujours compétent ; si au contraire une violation contractuelle peut rester strictement contractuelle sans pénétrer le domaine délictuel, la réponse différente.
Également, le cadre juridique varie. La contrefaçon comporte des enjeux en droit pénal, que la violation contractuelle engendre rarement.
Les règles en matière de réparation peuvent aussi être modifiées. Alors que le contrat prévoit régulièrement des limites de responsabilité, le cadre juridique applicable à la propriété intellectuelle pose des principes différents et autorise même parfois une évaluation ex aequo et bono plus aisée.
Les faits
La Commission a conclu, le 22 décembre 1975, avec la société américaine World Translation Center Inc (WTC) un premier co ntrat portant sur l’installation et le développement d’un logiciel de traduction automatique (anglais – français) dénommé Systran (SYStem TRANslation), créé par cette société en 1968. Les relations entre la Commission et WTC, ultérieurement rachetée par la s ociété Gachot devenue ensuite Systran SA, se sont poursuivies, entre 1976 et 1987, par la signature de plusieurs contrats afin d’améliorer le système de traduction automatique, fonctionnant dans l’environnement Mainframe, dénommé « EC – Systran Mainframe », composé d’un noyau, de routines linguistiques et de dictionnaires pour neuf paires de langues de l a Communauté.
Le 4 août 1987, Systran et la Commission ont conclu un « contrat de collaboration » portant sur l’organisation en commun du développement et de l’amélioration du système de traduction Systran pour les langues officielles, actuelles et futures de la Communauté, ainsi que sur sa mise en application. Le contrat prévoyait que la loi belge était applicable en cas de différend entre les parties. Entre 1988 et 1989, la Commission a conclu quatre contrats avec Systran afin d’obtenir « une licence d’utilisation » du système de traduction automatique pour cinq paires supplémentaires de langues. Au mois de décembre 1991, la Commission a mis fin au contrat de collaboration considérant que Systran n’avait pas respecté ses obligations contractuelles. À la date où ce contrat a pris fin, la version EC – Systran Mainframe du système de traduction automatique Systran comportait seize versions linguistiques.
Par la suite, le groupe Systran a créé et commercialisé une nouvelle version du système de traduction automatique Systran à même de fonctionner sous les systèmes d’exploitation Unix et Windows (« Systran Unix ») alors que la Commission a développé la version EC – Syst ran Mainframe, en partie avec l’aide d’un cocontractant extérieur.
Le 22 décembre 1997, Systran Luxembourg et la Commission ont conclu le premier de s quatre contrats de migration afin d e permettre au logiciel EC – Systran Mainframe de fonctionner sous Unix et Windows. Lors de la signature de ce premier contrat, Systran a donné son accord pour que la Commission utilise, d’une part, la marque Systran de manière systématique pour tout système de traduction dérivant du système de traduction automatique Systran d ’origine, pour la diffusion ou la mise à disposition de ce système et, d’autre part, les produits Systran sous environnement Unix et/ou Windows pour ses besoins internes. Le premier contrat de migration prévoyait que le système de traduction automatique de la Commission, y compris ses composants, même modifiés restait la propriété de la Commission, à l’exception des cas où des droits de propriété industrielle ou intellectuelle existaient déjà. Aux termes de ce contrat, la loi luxembourgeoise était applicabl e en cas de différend. Le contrat de migration devait prendre fin le 15 mars 2002 et Systran Luxembourg devait apporter, à cette date, la preuve actualisée de tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle revendiqués par le groupe Systran et liés au système de traduction automatique. Selon la Commission, Systran Luxembourg ne lui a pas communiqué ces informations.
Le 4 octobre 2003, la Commission a lancé un appel d’offres pour la maintenance et le renforcement linguistique de son système de t raduction automatique. Cependant, Systran a indiqué à la Commission, par courrier du 31 octobre 2003, que les travaux envisagés dans l’appel d’offres étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et l’invitait à se pronon cer à cet égard. Systran précisait qu e, d ans ces conditions, elle ne pouvait répondre à l’appel d’offres. Par courrier du 17 novembre 2003, la Commission a répondu que le groupe Systran n’avait pas apporté la preuve des droits de propriété intellectuelle q ue Systran invoquait sur le logiciel de traduction automatique Systran et qu’elle considérait que Systran ne pouvait s’opposer aux travaux réalisés par la société belge Gosselies SA, qui avait remporté l’appel d’offres pour deux lots sur les huit. À la sui te de cet appel d’offres , le groupe Systran, a considéré que la Commission a vait divulgué illégalement son savoir – faire à un tiers et qu’elle avait réalisé un acte de contrefaçon à l’occasion de la réalisation par l’attributaire du marché de développements non autorisés de la version EC – Systran Unix .
La procédure
Systran a donc saisi le Tribunal de l’Union européenne d’ une action en indemnisation du dommage qu’elle prétend avoir subi.
Le Tribunal, par arrêt rendu en 2010, a jugé que le litige n’était pas de nature co ntractuelle et que, partant, il était compétent pour en connaître. Si le Tribunal a rejeté les demandes pour autant qu’elles concernaient la filiale Systran Luxembourg, il a, en revanche, reconnu que le comportement de la Commission avait causé à la sociét é mère un préjudice matériel pour perte de valeur de ses actifs incorporels (c’est – à – dire la perte de la valeur de ses droits de propriété intellectuelle), évalué de manière forfaitaire à 12 millions d’euros, et un préjudice moral évalué à 1 000 euros.
La Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice afin d’annuler c et arrêt. Elle fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le litige était de nature non contractuelle et en concluant au droit à indemnisati on de Systran.
L’arrêt rendu
Dans son arrêt, la Cour rappelle que, lorsque les juridictions de l’Union sont saisies d’un recours en indemnité, comme en l’espèce, celles – ci doivent, avant de se prononcer sur le fond du litige, déterminer leur compétence en procédant à une analyse visant à établir le caractère de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle invoquée et donc la nature même du litige.
À ces fins, ces juridictions doivent vérifier, au regard d’une analyse des différents éléments du dossier, tels que notamment la règle de droit prétendument violée, la nature du préjudice invoqué, le comportement reproché ainsi que les rapports juridiques existants entre les parties en cause, s’il existe entre celles – ci un véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, dont l’examen approfondi se révèle indispensable pour trancher ledit recours. S ’il ressort de l’analyse liminaire desdits éléments qu’il est nécessaire d’interpréter le contenu d’un ou de plusieurs contrats conclus entre les partie s en cause pour établir le bien – fondé des prétentions du requérant, lesdites juridictions sont tenues d’arrêter , à ce stade , leur examen du litige et de se déclarer incompétentes pour statuer sur celui – ci, en l’absence de clause compromissoire 2 dans lesdit s contrats .
Or, dans cette perspective, force est de constater que le Tribunal a commis une première erreur de droit dans l’application des principes gouvernant la détermination de la compétence juridictionnelle dans le cadre des recours en indemnité dirigés contre la Communauté . En effet, il ne s’est pas limité à vérifier, s’agissant de la recevabilité du recours, s’il existait entre les parties, au regard des différents éléments du dossier, un véritable contexte contractuel. Au contraire, le Tribunal a effectué déjà au stade de la détermination de sa compétence, un examen détaillé du contenu des nombreuses dispositions contractuelles, de 1975 à 2002, régissant les relations économiques et commerciales entre le groupe WTC/Systran et la Commission, afin de vérifier si celle-ci disposait d’une autorisation pour divulguer à un tiers des informations protégées par le droit d’auteur et le savoir-faire détenus par Systran sur la version Systran Unix du système de traduction automatique Systran. En effet, le Tribunal a estimé que le caractère contractuel de la responsabilité de la Communauté dépendait de l’existence de cette autorisation. Une telle analyse, toutefois, comme le soutient à juste titre la Commission, concernait le caractère légal ou illégal du comportement reproché à cette institution, et relevait donc du fond du litige et non de la détermination liminaire de la nature même de ce litige.
Dans ce contexte, le Tribunal a aussi commis une autre erreur de droit sur la qualification juridique des contrats conclus de 1975 à 2002 entre le groupe WTC/Systran et la Commission. En effet, il a jugé à la lumière des différents éléments du dossier, que l’existence de ces contrats n’avait pas d’incidence sur la qualification du litige. Or, il est constant que les nombreux documents contractuels invoqués par la Commission devant le Tribunal, dont notamment le contrat du 22 décembre 1975 conclu par la Commission et WTC, les contrats conclus de 1976 à 1987 avec les sociétés du groupe WTC, parmi lesquels revêt une importance particulière l’accord de coopération technique du 18 janvier 1985 passé avec Gachot, le contrat de collaboration, les contrats de licence passés avec Gachot entre 1988 et 1989 ainsi que les contrats de migration, configurent un véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, dont l’examen approfondi se révélait indispensable pour établir l’illégalité éventuelle du comportement reproché à la Commission.
Dès lors, force est de constater que le Tribunal a considéré à tort que le litige était de nature non contractuelle.
Dans ces conditions, la Cour annule l’arrêt du Tribunal. En outre, la Cour statue définitivement sur le litige, estimant qu’il est en état d’être jugé, et affirme à cet égard que les juridictions européennes ne sont pas compétentes pour connaître du recours en indemnité introduit par le groupe Systran. Pour cette raison, celui-ci doit être rejeté.
Commentaires
On l’a vu, les faits sont spécifiques et il faut se garder de tirer des conclusions hâtives. Par ailleurs, la cour était invitée à trancher un litige relatif à la compétence du tribunal de première instance des communautés européennes et on ne peut dès lors extrapoler qu’avec prudence lorsqu’on en tire des conclusions valables de façon générale en matière de propriété intellectuelle.
Il n’empêche que l’arrêt montre clairement l’interaction entre l’enjeu contractuel d’une part, et l’enjeu délictuel d’autre part, et en tire des conséquences très concrètes au niveau de la compétence. Par ailleurs, rien ne nous semble s’opposer à raisonner pareillement dans tout litige – est le cas est fréquent – dans lequel la contrefaçon alléguée est reprochée à une personne que le titulaire des droits connaît bien puisqu’il s’agit de son contractant.
Dans un arrêt de 2010, la Cour de Cassation de Belgique avait notamment estimé que « celui qui méconnaît les limites de l’autorisation d’exploitation délivrée par le titulaire de droits d’auteur ou des droits voisins commet un acte de contrefaçon, indépendamment de toute faute contractuelle. Le juge de la cessation peut dès lors constater l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins et ordonner sa cessation si l’exploitant ne s’acquitte pas des obligations imposées par le titulaire en échange de son consentement. »
La cour de justice, dans le cadre précis qui lui était présenté, n’a pas eu exactement la même lecture.
L’avenir dira ce que les plaideurs feront de cette porte ouverte.