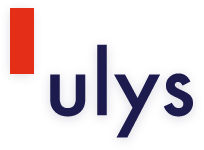Le droit à l’oubli peut-il aller jusqu’à entraîner la modification des archives de presse ?
Publié le 07/06/2016 par
Etienne Wery
Quand deux Cours suprêmes répondent en sens diamétralement opposés à une question similaire, le juriste reste sur sa faim et se gratte le menton : que faire ? C’est ce qui vient de se produire : les Cours de cassation belge et française arrivent à des conclusions opposées en matière de droit à l’oubli. Il est temps de siffler la fin de la récréation.
Imaginons la situation suivante :
· Il y a plusieurs années, un citoyen fait l’objet d’un fait d’actualité. Par exemple, il est impliqué dans un grave accident de la circulation. À l’époque, la presse se fait l’écho de l’accident. Il faut dire qu’il y a des morts et plusieurs blessés. Le chauffard est identifié ou identifiable.
· Depuis lors, le journal qui a relaté les faits a basculé toutes ses archives sur Internet. Elles sont en accès libre et gratuit.
· Première conséquence : s’il l’on fait une recherche dans les archives du journal, on tombe sur l’article de l’époque.
· Seconde conséquence : si l’on fait une recherche sur Google, Bing, ou tout autre moteur de recherche, on tombe sur un lien vers les archives du journal qui ont été indexées.
Aujourd’hui, le citoyen en question a bien changé. Il a pris 20 ans de maturité, il a un métier, il est marié et père de famille, et il n’en peut plus de voir son nom apparaître à chaque requête. Il en souffre d’autant plus qu’il exerce une profession libérale, ce qui signifie qu’il n’est pas rare que des clients se livrent à une recherche le concernant avant de le consulter. On imagine qu’un certain nombre d’entre eux hésiteront à lui confier une affaire s’ils font le lien avec l’article.
Il s’adresse donc au journal et demande de supprimer l’article ou de l’anonymiser.
Deux cours suprêmes ; deux logiques différentes
La Cour de cassation belge a rendu le 29 avril 2016 un arrêt qui énonce notamment que « L’archivage numérique d’un article ancien de la presse écrite ayant, à l’époque des faits, légalement relaté des événements du passé désormais couverts par le droit à l’oubli ainsi entendu n’est pas soustrait aux ingérences que ce droit peut justifier dans le droit à la liberté d’expression.
Ces ingérences peuvent consister en une altération du texte archivé de nature à prévenir ou réparer une atteinte au droit à l’oubli. »
La Cour de cassation belge approuve donc l’arrêt d’appel qui avait procédé à une mise en balance des intérêts et jugé que « le maintien en ligne de l’article litigieux non anonymisé, de très nombreuses années après les faits qu’il relate, est de nature à lui causer un préjudice disproportionné par rapport aux avantages liés au respect strict de la liberté d’expression [du demandeur] » et que « les conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité imposées par l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à toute limitation de la liberté d’expression sont en l’espèce réunies ».
La Cour de cassation française a quant à elle rendue le 12 mai 2016 un arrêt qui énonce notamment que « en retenant, par des motifs non critiqués, que le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l’édition d’une base de données de décisions de justice, l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche. »
Deux approches opposées :
· une approche belge qui tolère qu’au nom du droit de la personnalité d’un individu, un organe de presse puisse être amené à devoir modifier le contenu de ses archives mises en ligne et librement disponibles ;
· une approche française qui considère qu’une telle mesure excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse.
Régler une question préalable : droit des données personnelles ou droit de l’homme ?
Comprendre le raisonnement des deux Cours de cassation nécessite de régler une question préalable : quel est le domaine juridique dont le droit à l’oubli relève ?
On sait que le (très mal nommé) droit à l’oubli est au départ une création jurisprudentielle de la Cour de justice de l’Union européenne : la Cour était saisie d’une question préjudicielle portant sur l’application de la directive 95/46. Sur le plan de la technique juridique, l’arrêt Costeja a rendu possible la reconnaissance d’un droit à l’oubli en se fondant sur les droits de correction et d’opposition reconnus aux personnes concernées par la Directive 95/46 sur la protection des données personnelles.
Mais le droit à l’oubli est-il être confiné au droit des données à caractère personnel, ou faut-il au contraire l’inclure dans la sphère plus large des droits de la personnalité ?
Derrière cette question quasi philosophique, il y a un enjeu juridique majeur dès qu’on parle de droit de la presse.
En effet, pour des raisons de protection de la liberté d’expression, le droit des données à caractère personnel a toujours traité différemment la presse et les médias. C’est ainsi que l’article 9 de la directive de 1995 stipule que « Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. » En application de cette disposition, les articles 67 de la loi française et 3 de la loi belge créent un régime sur-mesure pour les médias (plus d’infos). Les régimes nationaux ne sont pas les mêmes, les Etats bénéficiant à la matière d’une marge de manœuvre appréciable.
L’objectif est évident : éviter que la liberté de la presse et des médias soit mise sous pression par l’exercice abusif de droits individuels qui pourraient la contrecarrer et, en fin de compte, la museler.
Il ne faut pas conclure de ce qui précède que tout exercice du droit à l’oubli est impossible dans le cadre d’un traitement effectué à des fins journalistiques, mais pareil exercice pourra être plus complexe, en fonction du droit national applicable, si la personne à qui l’on s’adresse bénéficie du régime favorable de la presse.
D’où l’intérêt pratique de la thèse selon laquelle le droit à l’oubli est une facette du droit à la vie privée au sens large. Une fois le principe de liberté de la presse posé, les droits fondamentaux sont en équilibre et les parties sont à armes égales, ce qui n’est pas nécessairement le cas en matière de droit des données personnelles appliqué aux médias.
Au demeurant, le droit des données à caractère personnel était l’arme juridique choisie par le plaignant dans l’affaire ayant amené à l’arrêt de la Cour de cassation française. Tactique consciente ou non, on ne le saura jamais, tout comme on ne saura jamais si c’est cela qui a amené la Cour de cassation à rejeter le pourvoi (c’est loin d’être certain, car l’attendu important est rédigé en termes très larges).
Très différente est la thèse suivie par la Cour de cassation belge dans l’arrêt commenté. Elle commence par rappeler que l’arrêt attaqué considère que « les parties […] bénéficient chacune de droits fondamentaux, étant pour [le demandeur] le droit à la liberté d’expression et pour [le défendeur] le droit au respect de la vie privée et familiale » ; que « ces deux droits […] ne sont ni absolus ni hiérarchisés » ; que « l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales autorise des limitations à la liberté d’expression si elles sont prévues par la loi, si elles poursuivent un but légitime et si elles répondent à un impératif de proportionnalité ».
La Cour suprême conclut que : « Il suit de ces motifs, d’une part, que l’arrêt attaqué tient, comme il l’énonce d’ailleurs, le droit à l’oubli numérique pour une « composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée » et considère que l’ingérence que la protection de ce droit peut justifier dans le droit à la liberté d’expression est fondée, non sur la doctrine et la jurisprudence, auxquelles il ne reconnaît pas une portée générale et réglementaire, mais sur les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 22 de la Constitution, d’autre part, qu’il ne se réfère à l’arrêt qu’il cite de la Cour de justice de l’Union européenne que pour soutenir la portée qu’il prête à ce droit à l’oubli.»
Les contraintes de l’approche fondée sur les droits de l’homme
La Cour de cassation belge est la première, à notre connaissance, à sortir du cadre limité du traitement des données à caractère personnel, pour oser déplacer le débat vers les dispositions plus générales protégeant la vie privée, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Comme souvent lorsqu’une décision essuie les plâtres, elle pose plusieurs questions. C’est à la réflexion que l’on perçoit les limites de l’approche, qui demandent à être affinées.
Relevons quelques difficultés.
– Le principe de légalité.
En résumé, une ingérence dans l’exercice d’une liberté fondamentale (dont la liberté d’expression fait indiscutablement partie, et plus encore en matière de presse et média), doit être prévu par la loi. L’exigence de légalité implique l’existence, sur le plan formel, d’un texte, mais cela va au-delà : il faut aussi que ce texte respecte certains critères de qualité : la norme doit être « énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite et de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé ».
Or, lorsque la Cour de cassation belge invoque les articles 8 de la Convention de sauvegarde, 17 du pacte international et 22 de la constitution, c’est quelque part le serpent qui se mord la queue : toutes ces dispositions prévoient la possibilité d’ingérence sous réserve que celle-ci soit prévue par la loi. Ces dispositions ne peuvent donc pas être la loi en question.
En sortir via l’article 1382 du Code civil et la mise en cause de la responsabilité quasi délictuelle de l’organe de presse ou de son éditeur responsable (selon l’arrêt de la cour d’appel, « cette faute consiste dans le maintien en l’état, depuis 2010, de la version électronique de l’article litigieux du 10.11.1994, sans l’anonymiser ou le pourvoir de balise de non indexation, alors qu’une demande raisonnable et motivée lui avait été adressée en ce sens »), peut certes se concevoir en théorie (la Cour de Strasbourg l’a déjà admis) mais laisse néanmoins rêveur. À ce rythme, on peut justifier énormément d’ingérences.
– Le principe de finalité.
L’ingérence ne peut être admise que si elle sert une finalité légitime. En fonction du texte pris en compte, les finalités admises sont parfois limitées. Par exemple, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’admet l’ingérence de l’autorité publique dans le droit à la vie privée que si celle-ci est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui.
La responsabilité quasi délictuelle est forcément en lien avec la protection des droits et libertés d’autrui. Mais c’est un peu flou tout de même, a fortiori lorsque que comme en l’espèce, c’est l’appréciation marginale du journal qui fonde la faute : avoir mal apprécié la demande qui lui a été faite sachant l’information était au départ licite et vraie.
– Les principes de nécessité et proportionnalité.
Les divers textes formulent ces principes différemment, mais l’idée sous-jacente est la même : l’intrusion doit s’arrêter à ce qui est nécessaire, et être proportionnée à l’objectif poursuivi. S’il y a moyen d’arriver à satisfaire l’objectif poursuivi via une mesure moins intrusive, il faut la privilégier.
C’est probablement l’un des écueils principaux du droit à l’oubli appliqué aux archives de presse.
Il y a une ligne symbolique qui est franchie dès l’instant où l’exercice du droit à l’oubli nécessite de modifier le contenu initial. Une décision ordonnant de pourvoir les archives de balises de non-indexation par les moteurs de recherche aurait posé moins de questions. Cela aurait eu pour effet de forcer celui qui recherche une information à se rendre directement à la source (sur le site du journal). Mais ce n’est pas ce que la cour a décidé. Elle a validé une modification d’un contenu qui était à la base licite et vrai. Certes, la modification se limite à l’anonymisation, mais tout de même : c’est une modification et symboliquement c’est un message très (trop ?) fort.
C’est aussi dans le cadre de la nécessité et de la proportionnalité que l’on prendra en compte l’ensemble des éléments de fait. À commencer par la nature des faits relatés dans l’article initial, et la personnalité de celui qui se plaint, son rôle dans la société, le caractère public ou non de ses mandats, etc.
Et maintenant ?
En ce début d’été 2016, on a donc deux décisions de Cours de cassation, rendues en sens contraire.
On l’a vu, il faut se garder de généraliser la contradiction, notamment en raison des choix tactiques différents du plaignant : droit des données personnelles d’un côté, droit à l’oubli au sens des droits de fondamentaux de l’autre.
Il n’empêche : les deux cours suprêmes ont rendu des décisions dont les attendus peuvent être considérés comme ayant une portée générale.
il est temps d’harmoniser les choses. Il faut souhaiter que l’un des perdants, belge ou français, porte l’affaire à Strasbourg et que la Cour rende un arrêt de principe.