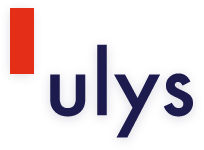La consultation de sites pornographiques sur le lieu de travail : motif grave ?
Publié le 05/01/2006 par patrice bonbled
L’employeur peut contrôler les données de communications électroniques transmises ou reçues par son personnel. Ce contrôle doit être concilié avec le droit au respect de la vie privée. Un motif grave ne doit pas être lié au contenu des messages électroniques échangés. Leur fréquence et la non exécution du travail peuvent suffire. Faut-il admettre de…
L’employeur peut contrôler les données de communications électroniques transmises ou reçues par son personnel. Ce contrôle doit être concilié avec le droit au respect de la vie privée. Un motif grave ne doit pas être lié au contenu des messages électroniques échangés. Leur fréquence et la non exécution du travail peuvent suffire.
Faut-il admettre de revoir une formule connue et la travestir en « métro-boulot-porno » ?
La tentation est grande lorsque certains médias nous rapportent qu’une dizaine d’employé ont été licenciés pour motifs graves par une importante société belge.
Il leur serait reproché d’avoir consulté, au travail, par l’intermédiaire de leur ordinateur, des sites pornographiques reproduisant des scènes de tortures et de sévices sexuels.
Cette actualité datant de quelques jours permet de « rafraîchir » les données d’une jurisprudence des juridictions sociales en la matière, soit la possibilité pour l’employeur de contrôler l’ordinateur qu’il met à disposition de son personnel.
Le contrôle avant 2002
Jusqu’en 2002, le contrôle par l’employeur de l’utilisation par son personnel de l’outil informatique n’était pas aisé, ni même admis.
Ainsi, le tribunal du travail de Verviers (JTT 2002, p. 183) avait considéré que la preuve d’un motif grave obtenue par ce contrôle était illicite et ne pouvait être prise en considération.
Se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris (2 octobre 2001), il relevait que le salarié a droit, même au travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Un employeur ne peut donc prendre connaissance de messages personnels, émis par un travailleur, ou reçus par lui, grâce à un outil informatique appartenant à l’entreprise.
Dès lors, si pas de preuves, pas de motif grave.
Le tribunal du travail de Bruxelles (JTT 2002, p.52) a, par contre, pu confirmer le licenciement pour motif grave d’un employé qui avait consacré au cours de trois semaines, plus de 70 heures de consultation de sites boursiers qui n’avaient aucun rapport avec son activité professionnelle.
Dans la même veine, un jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 2 mai 2000 a déjà été commenté dans cette chronique ( P.Bonbled, L’Echo 3 juin 2000, « Message de Robert à Denise »).
Pour rappel, il avait à examiner la régularité et la validité d’un licenciement pour motif grave d’un employé qui avait consacré une partie importante de son temps de travail à « dialoguer » avec une autre employée du même bureau.
Cette conversation électronique était fort intime et reflétait, selon la lettre de rupture en termes choisis, des « pensées libertines ».
Le jugement prononcé a rejeté toute idée de faute grave en condamnant l’employeur à payer une indemnité compensatoire de préavis, tout en condamnant l’employé à des dommages et intérêts pour le préjudice causé à la société dans l’exécution de son contrat de travail.
En cela, il a suivi en partie la thèse de l’employé qui estimait que le listing contenant l’ensemble des messages électroniques échangés ne pouvait être produit, sur base de la Convention européenne des droits de l’homme soulignant le respect du droit au respect de la vie privée.
Or, pour être en mesure d’invoquer une faute grave, l’employeur souhaitait déposer ce document établissant la réalité du contrôle exercé sur l’exécution du travail de son employé et éclairer le tribunal sur la teneur des messages échangés et sur la nature des relations de ces deux membres du personnel.
Le tribunal avait admis que ce contrôle était possible mais il ne pouvait accepter que lui soient produits les messages en cause.
Par contre, le simple relevé de ceux-ci avec indication de leur nombre, des dates et heures d’envoi ou de réception pouvait suffire pour établir une non exécution du travail qui avait été convenu.
Mais comment alors établir la réalité de la faute grave ?
Le tribunal a jugé que le fait d’avoir échangé un très grand nombre de messages n’était pas suffisant pour répondre à la définition légale d’un motif grave.
Le jugement relève que l’employeur s’est abstenu de tout contrôle avant de demander un premier rapport sur l’exécution du travail demandé seulement quelques jours avant le constat d’existence de ces courriers internes.
Il s’agissait, selon le tribunal, d’une « persistance du laisser-faire » qui réduit l’impact de la gravité des faits invoqués par l’employeur.
Le contrôle de la Cour.
Plus de cinq ans plus tard, le dossier fut soumis à la Cour du travail de Bruxelles qui vient de se prononcer (arrêt du 22 novembre 2005, R.G. n° 46.320W, 4e chambre).
Elle confirme que le contenu des messages échangés entre les employés d’une entreprise, même sur leur lieu de travail, appartient à leur vie privée.
Elle examine par contre la question de la preuve sous deux aspects distincts :
-
la légitimité du contrôle sur les e-mails échangés et la régularité de la preuve
-
l’opportunité de la production du contenu de ces messages face au respect de la vie privée.
La Cour reconnaît que l’employeur avait le droit de contrôler, en respectant les règles de nécessité et de proportionnalité prévues par la Convention des droits de l’homme, l’emploi du temps de l’employé, son usage de la messagerie interne et, « dans une certaine mesure » le contenu des messages.
L’employé ne conteste d’ailleurs pas la régularité de ce contrôle puisqu’il ne s’oppose pas à ce que le relevé des messages, limité aux noms des destinataires, dates et heures d’envoi, soit déposé.
Quant à l’administration de la preuve, la Cour rappelle qu’un juge doit avoir égard à la finalité de celle-ci.
Selon elle, la faute grave n’est pas à rechercher dans la teneur des messages très privés échangés mais dans leur nombre particulièrement élevé, qui est susceptible de révéler une non exécution du contrat de travail.
Dès lors, la lecture du contenu des messages n’est pas « utile à la manifestation de la vérité », et la production de la teneur de chaque message n’est ni nécessaire, ni indispensable, ni proportionnée. Tant pis pour les voyeurs ou les curieux.
Reste la question principale : y a-t-il place pour une faute grave ?
Si le tribunal a répondu négativement, la Cour n’est pas du même avis.
Elle relève que l’employé a fait un usage « tout à fait démesuré et proprement abusif » de la messagerie interne de l’entreprise.
A titre documentaire, elle relève l’existence de 627 messages donnés ou reçus sur 9 jours calendriers, soit près de 70 par jour…
Ou encore de 1160 messages au cours d’un mois et demi.
De plus, l’employé connaissait, pour en être l’auteur, l’existence d’une note interne rappelant l’utilisation strictement professionnelle de l’e-mail.
Enfin, il savait que sa mission était importante et urgente pour l’entreprise et qu’elle ne permettait aucune désinvolture.
L’homme soi-disant débordé tenait un double langage alors qu’il savait qu’il n’exécutait pas le travail convenu
Contredisant le tribunal, la Cour relève que le contrôle de l’employeur a été effectué rapidement et que les messages internes constatés ont couvert une période de moins de deux mois précédant le licenciement.
La Cour aurait aussi pu tenir compte du fait qu’envoyer autant de messages nécessitait l’élaboration de ceux-ci, leur rédaction, l’imagination de leur impact chez la destinataire, l’imagination de la réponse et la lecture de celle-ci. Cela s’appelle du travail « en ligne »…mais pas pour l’employeur.
Un dernier point restait à trancher : l’employé devait-il être condamné à des dommages et intérêts du fait du retard apporté à l’exécution de la mission qui lui avait été confiée ?
L’examen du dossier fait apparaître que les manquements reprochés à l’employé ne sont pas à eux seuls à l’origine de ce retard, qu’il s’est senti délaissé ou pas suffisamment accompagné dans l’exécution d’une fonction qui dépassait ses compétences.
Le préjudice subi par l’employeur n’est pas la conséquence directe et nécessaire du manquement reproché qui ne peut donc être sanctionné par des dommages et intérêts.
Après 2002
Il n’est pas inutile de rappeler qu’un arrêté royal du 12 juin 2002 a rendu obligatoire une convention collective du travail n°81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau.
Son seul objet est de veiller à garantir cette protection lorsqu’une collecte de données de communications électroniques en réseau est instaurée sur le lieu de travail pour en faire le contrôle et les traiter de manière à les attribuer à un travailleur.
Elle ne règlemente pas l’accès ou l’utilisation par le travailleur des moyens de communications électroniques en réseau au sein de l’entreprise et dont les règles sont à déterminer par l’employeur, après éventuellement information et consultation du personnel.
En ce qui concerne le principe de « transparence », la CCT prévoit la possibilité d’individualiser un contrôle notamment en vue de prévenir des faits illégaux, contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui.
Le travailleur est alors « invité » à un entretien préalablement à l’adoption de « toute décision susceptible de l’affecter individuellement ».
Tel sera le cas, selon les commentaires joints à cette CCT, en cas de consultation de sites à caractère pornographique ou pédophile.
Qui se souvient que Voltaire écrivait en 1759 : « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin ».
Encore faut-il que ce travail soit contrôlé et que l’employeur ne s’appelle pas Candide.