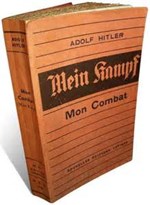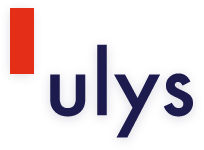Interdire Mein kampf ? Fausse bonne idée.
Publié le 20/01/2016 par
Etienne Wery
Hasard du calendrier : en deux semaines, deux partis (qui ne s’aiment pourtant pas) ont risqué le dérapage en matière de liberté d’information. Deux cas d’école très différents, mais porteurs d’enseignement : la liberté d’information n’est pas un long fleuve tranquille. Malgré une courbe rentrante, le mal est fait.
Mein kampf
Qui n’a jamais entendu parler de Mein kampf, le pamphlet écrit par Hitler pendant qu’il était en prison ? Véritable réquisitoire anti-juif, le livre est la référence du parfait petit nazi.
Depuis la fin de le seconde guerre mondiale, les droits sur le livre étaient entre les mains du Land de Bavière (l’Etat), qui a toujours veillé à ne pas permettre sa réédition pour éviter de banaliser les idées nauséabondes qu’il contient.
Règle de droit d’auteur oblige : depuis le 1er janvier 2016, les droits sont tombés dans le domaine public.
En Allemagne, le livre fait un véritable tabac. Il faut dire qu’un éditeur connu de la place s’est saisi du projet pour le transformer en œuvre pédagogique. Le livre est accompagné de références historiques, d’explications et d’analyses, destinées à contextualiser et à guider le lecteur vers une réflexion qui dépasse le message premier du livre. Loin des clichés, l’Allemagne est l’un des pays les plus en pointe dans la lutte contre le fascisme ; elle affronte ses démons sans la moindre complaisance.
En Belgique, un député membre du parti MR (au pouvoir au niveau fédéral) a proposé d’interdire purement et simplement le livre sur le territoire belge.
Au départ, plusieurs collègues de parti ont trouvé l’idée séduisante : il s’agissait de montrer l’attachement du parti aux valeurs de liberté et de respect, et de faire de la lutte contre la haine raciale un axe majeur de sa politique.
À la réflexion toutefois, l’idée est explosive.
En effet, même si le but est louable, il reste qu’il s’agit d’une censure visant un livre en particulier. Cela rappelle d’autres époques qui n’ont pas nécessairement bonne réputation en matière de respect des droits humains. Allait-on revivre l’imprimatur, l’inquisition ou les autodafés ?
Le débat a vite débordé le parti, qui vient d’y mettre bon ordre.
D’un point de vue pratique, certains ont relevé que s’il fallait interdire tous les livres trop sensibles il y aurait beaucoup de candidats. Que faire des livres de référence des religions monothéistes : à côté de leur message de paix, ils contiennent plusieurs passages qui sont des appels au massacre. Que faire des livres de Marx, Lénine ou Staline, ou d’œuvres qui font partie du grand patrimoine littéraire mais ont été écrites par des auteurs ouvertement d’extrême-droite ?
D’un point de vue juridique, on peut aussi mettre en avant le fait que le droit à l’information n’est pas que le droit de fournir une information, mais aussi le droit d’y accéder.
Aussi condamnable soit son contenu, Mein Kampf est – qu’on le veuille ou non – une page de l’Histoire du monde. Le dossier est délicat, car on navigue entre banalisation d’un message de haine et droit à connaitre l’Histoire, toute l’Histoire.
Fallait-il interdire aux Belges de prendre connaissance d’un livre que leurs voisins peuvent consulter ? Fallait-il fermer les yeux devant le fait que le livre sera probablement rapidement disponible sur Internet et donc téléchargeable ?
En fin de compte, le parti a abandonné l’idée. Il préfère recommander aux éditeurs une approche similaire à celle qui prévaut en Allemagne : encadrer les rééditions par une mise en contexte. Il n’empêche que sur le plan de la communication, le mal est fait.
Le coup de sang de la ministre Milquet
Hasard du calendrier, la même semaine, un autre parti (CDH, dans l’opposition au niveau fédéral mais au pouvoir au niveau régional) se retrouve sous les feux de la critique.
Ce fut d’abord une émission de télévision qui a mal tourné. La ministre Milquet (ex chef de parti, ex ministre fédérale) a accepté de participer à l’une de ces nombreuses émissions qui traitent dorénavant de la politique sur un ton de divertissement. Malheureusement, elle s’est emportée lors du tournage et la belle opération de communication se retourne contre elle.
Quelques jours, plus tard, lors du pince-fesses du parti pour les vœux de nouvel-an, un micro indiscret d’une émission d’enquête de la télévision publique belge a enregistré une conversation entre Madame Milquet et un autre ministre.
Celle-ci n’apprécie pas et le fait savoir. Elle accuse la presse d’une « dérive généralisée » ; elle dénonce l’infotainment (l’information devient un divertissement) ; elle demande une réforme du code de déontologie journalistique.
Bigre !
Chacun aura son propre avis sur l’intérêt politique des émissions qui mêlent actualité et divertissement. Mais il reste une question plus fondamentale : si l’évolution déplaît à une ministre, pourquoi accepte-t-elle d’y participer ? A-t-elle été piégée ? Après 30 ans de carrière politique, on en doute.
Reste la question plus délicate de l’enregistrement lors de la cérémonie des vœux.
Il semble qu’à un moment de la cérémonie, le président du parti a intelligemment fait passer le message : à partir de maintenant, on est en « off ». Les journalistes n’ont, semble-t-il, pas compris ou pas voulu comprendre le message.
Faut-il dès lors crier à l’intrusion dans la vie privée, comme le font certains observateurs ? La réponse est probablement non. Lorsque deux personnages publics, élus, ministres aux commandes de l’État, discutent lors d’une cérémonie officielle du parti à laquelle la presse est invitée, il devient difficile de plaider l’intrusion dans la sphère privée. Il n’est guère probable qu’ils discutent de la rougeole de la petite dernière.
Ceux qui affirment le contraire confondent intrusion dans la sphère privée, et captation d’une information confidentielle.
C’est une confusion fréquente et malheureuse.
Il est évident que la presse ne peut remplir son rôle de chien de garde de la démocratie que si elle dépasse l’information que le pouvoir veut bien lui servir. A défaut, elle devient comme la Pravda à l’époque du totalitarisme soviétique. Certains pays fonctionnent encore comme cela : la Corée du Nord par exemple où – c’est bien connu – chacun rêve de vivre.
Sans ce droit fondamental et cette liberté accordée à la presse, il n’y aurait pas eu le Watergate, les États-Unis continueraient à financer en sous-main la guérilla au Nicaragua, on penserait toujours que le bateau de Greenpeace a explosé parce qu’il était trop vieux, et Edward Snowden serait toujours informaticien au service de la CIA …
Il reste que le journaliste a manifestement enfreint une demande de « off ».
Toute personne habituée à fréquenter les médias sait ce que cela signifie : pour faire son métier d’investigation, le journaliste a besoin de sources ; pour que les sources lui fassent confiance, elles doivent pouvoir se confier en « off ». Violer cette règle, c’est rompre la confiance. Le problème n’est, n’en déplaise à la ministre, ni juridique ni déontologique. Il est bêtement pratique : si le journalisme d’investigation n’applique plus les codes tacites qu’il a lui-même établi, il risque de se retrouver à terme sans source et donc sans information.