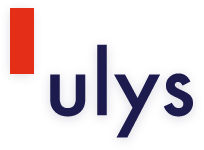Confusion et suspicion autour des documents d’origine électronique
Publié le 25/02/2001 par Jean-Luc Tagliamonte
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2000, la Cour d’Appel de Besançon a pris une position qui témoigne à la fois d’une certaine défiance envers l’écriture électronique et de la difficulté persistante, voire croissante, d’avoir une représentation claire et commune, en termes juridiques, des techniques employées aujourd’hui. Suite à une décision rendue par un…
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2000, la Cour d’Appel de Besançon a pris une position qui témoigne à la fois d’une certaine défiance envers l’écriture électronique et de la difficulté persistante, voire croissante, d’avoir une représentation claire et commune, en termes juridiques, des techniques employées aujourd’hui.
Suite à une décision rendue par un Conseil de Prud’hommes, un avocat a fait appel de cette décision au moyen d’un acte écrit édité sur papier, sur lequel sa signature avait été apposée non pas de façon manuscrite, mais grâce à un outil informatique permettant, moyennant l’utilisation d’un identifiant, la reproduction de la signature préalablement « scannée ».
La partie adverse a fait valoir l’irrecevabilité de l’appel ainsi interjeté, au motif de la non conformité du procédé utilisé pour signer avec les dispositions de la loi nouvelle portant adaptation du droit de la preuve et en particulier, l’article 1316-4 du code civil qui prévoit que, lorsqu’une signature est électronique, « elle consiste en l’usage d’un procédé fiable garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
A juste titre, la Cour a refusé l’application de la loi, les faits étant antérieurs à sa promulgation. Néanmoins, en dépit de ce refus d’application, les juges ont motivé leur décision en se référant au texte de la loi, décidant finalement que <i<"la fiabilité du procédé utilisé en l'espèce par l'avocat est toute relative", pour conclure à l’irrecevabilité de l’acte d’appel. Il semble que la Cour ait vu dans « l’origine électronique » de la signature une circonstance importante au point de prendre le pas sur une approche et des principes plus classiques, qui auraient pu trouver à s’appliquer.Cette espèce a le mérite de mettre en évidence certaines difficultés de lecture des article nouveaux du code civil après la loi de mars 2000, qui ont peu de chance d’être réduites par la prochaine publication du décret d’application.
Le caractère « électronique » du procédé de signature occulte la forme « papier » du message
Le juge s’est essayé à apprécier la « fiabilité » du procédé employé pour signer, entreprenant ainsi d’appliquer les principes nouveaux tirés de la loi de mars 2000 et retranscrits dans le Code Civil (art. 1316-1 à 1316-4). Il semble ainsi établi que nous ayons affaire à une « signature électronique ». Cette qualification implicite n’allait pas de soi. L’art. 1316-4, lorsqu’il commande pour une signature électronique l’usage d’un procédé fiable « garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache », traduit le souci de l’intégrité du message émis sous forme électronique, donc théoriquement soumis à un risque spécial d’altération par malveillance ou accident après son émission. Ces notions et ce vocabulaire sont un reflet de ceux qu’on trouve dans la Directive européenne de décembre 1999, qui utilise les concepts propres à la cryptographie à clés publiques, où un signataire utilise sa clé privée pour signer des messages qui sont authentifiés par le destinataire grâce à la clé publique du signataire, laquelle est publiée et gérée par un tiers dit « certificateur ». Tout a été pensé dans ces textes en réponse à un risque donné, celui de l’altération d’un document sous forme électronique après son émission, et avec en perspective, des solutions sécurisant des messages « voyageant » sous cette forme électronique.
Dans le cas qui nous occupe, on est très éloignés de ce contexte particulier. Le document a été communiqué sous forme papier de A (le cabinet d’avocats) à B, (le greffe du tribunal). L’informatique ou « l’électronique » ne sont intervenus qu’en tant que mode d’apposition de la signature. Il apparaît donc peu douteux que de ce seul fait , l’article 1316-4 ne devait pas être appliqué.
Une deuxième caractéristique de l’approche du juge est que les exigences relatives à la signature prennent le pas sur les exigences procédurales normales en la matière. D’une part, dans la jurisprudence (Cass. Soc 17 juill. 1991, Bull. Civ n°371), la lettre recommandée destinée à interjeter appel des décisions prud’homales n’a pour objet que « de régler toute contestation sur la date d’appel ». D’autre part les textes ne mentionnent pas l’exigence d’une signature.
Quelles solutions auraient pu être suggérées par une approche plus classique ?
En laissant de côté le débat procédural relatif à la nécessité d’une signature et aux conséquences de son absence éventuelle, une démarche aurait pu consister à dire qu’il s’agissait d’un cas de signature non manuscrite sur un document papier. On se trouvait en présence d’une « griffe », peu important de savoir comment fonctionnait cette griffe. En règle générale, une signature doit être manuscrite. Ce n’est que lorsque la loi apporte une précision formelle qu’il peut en aller différemment (cf. la loi du 16 juin 1966 qui a validé et introduit à l’article 110 du Code de Commerce la signature du tireur à la griffe sur la lettre de change: « cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit »). Il faut insister sur le fait qu’une méthode électronique conduisant à l’apposition d’une signature sur papier ne pourra jamais se conformer aux dispositions de l’article 1316-4 ou de la directive européenne, en particulier parce que le destinataire ne pourra authentifier le message conformément aux termes de la loi, et parce que la signature n’est pas créée « par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif »: la divulgation de la signature permettant évidemment à tout un chacun de se donner les moyens de mettre au point une griffe informatique identique à très peu de frais.
Nous venons d’examiner, à l’épreuve de la jurisprudence, une difficulté de lecture des dispositions du code civil adaptées par la loi de mars 2000. Dans le prolongement de cette jurisprudence révélatrice, je propose d’examiner un autre aspect de la loi, révélateur également de la difficulté de cerner les notions utilisées.
Les contours de la notion de signature électronique, moins précis qu’il n’y paraît
La question qui s’est posée aux juges du fond et à laquelle ils ont répondu de façon implicite était: par « signature électronique », peut-on entendre « signature apposée de façon informatique » puis revêtant un document papier ?
Une autre question peut être formulée comme suit: par « signature électronique », peut-on entendre « signature manuscrite », transmise ensuite sous forme électronique et matérialisée sur papier à la réception (c’est le cas du fax). L’enjeu est de savoir si la reconnaissance juridique de la télécopie, revêtue d’une signature manuscrite avant transmission, est subordonnée au respect des exigences indiquées à l’article 1316-4 traitant de la signature électronique. Le mot « télécopie » n’apparaissant pas dans le texte nouveau du Code Civil, la première interrogation tient au point de savoir si la loi appréhende ce moyen technique. Une réponse peut être trouvée dans l’histoire du texte de loi modifiant le code civil: au cours de la procédure parlementaire était apparue une proposition de loi à l’initiative du Sénat, dont l’objet limité était de faire reconnaître la valeur probatoire des télécopies. Cette proposition inscrivait dans la loi les évolutions jurisprudentielles en matière de preuve par écrit, en élargissant les effets de la jurisprudence.
Le texte proposé complétait l’article 1334 du code civil par la formule suivante : « Les télécopies font foi entre les parties, sous réserve, en cas de doute, d’un examen approfondi permettant d’éliminer les pièces douteuses quant à leur intégrité et à l’imputabilité de leurs contenus « .
Cette proposition n’a pas été incorporée comme telle. Il serait donc possible de penser que la présente loi a esquivé la question du fax.
Certains éléments doivent cependant conduire à penser le contraire. En premier lieu, la proposition de loi a été retirée à l’initiative du Sénat (qui était à son origine), après constatation par les rapporteurs du Sénat que le projet de loi sur la signature électronique dans sa rédaction de février 2000 (celle que nous connaissons par la loi) « satisfaisait la proposition de loi n°244 sur la télécopie ». En second lieu, la lecture du texte de la loi, qui définit la preuve littérale indépendamment de son support et indépendamment du mode de transmission (article 1316), invite à tenir compte de la télécopie.
La conception qui se dégage est qu’il existe plusieurs modes d’établissement d’un écrit et que la télécopie est parmi ces modes. Cette conception doit rendre définitivement périmée l’idée que le fax est une copie d’un original qui resterait aux mains de son émetteur. Le seul écrit probant produit par la télécopie est en possession du destinataire. La circonstance que la transmission soit intervenue de façon électronique n’a pas en elle-même d’incidences sur la valeur probante du document. Il faudrait donc distinguer selon que « l’électronique » est un simple mode de transmission ou d’élaboration (le cas du fax, mais aussi celui du message sur papier signé avec une « griffe électronique », comme dans l’espèce jugée par la Cour de Besançon) ou au contraire un support permanent du message (le courrier électronique).
Quel retentissement cela a t’il sur le régime applicable à la télécopie et qu’en est-il de la signature du fax ?
Si le fax est un écrit susceptible de constituer une preuve littérale, sa signature doit être apposée et produire ses effets comme toute autre signature de n’importe quel autre écrit, à défaut de dispositions particulières dans la loi enjoignant de respecter une forme ou une procédure spéciales comme pour la signature électronique. Cela signifie qu’un écrit signé puis faxé peut constituer un acte sous seing privé s’il est opposé à son émetteur. Tout au plus le bon sens doit-il commander de rechercher si le message présente des apparences convaincantes d’avoir pour auteur la personne à qui on l’oppose. C’est dire, en somme, qu’il faut soit étendre l’application de l’article 1316-1 au cas du fax et donc observer la double condition « que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».), soit considérer que la jurisprudence née en droit commercial et commandant de vérifier « l’intégrité » et « l’imputabilité » du fax s’applique de façon général à toutes les télécopies.
Plus d’infos
- En consultant notre actualité du 19 décembre 2000
- En consultant le texte du jugement commenté, en ligne sur ce site